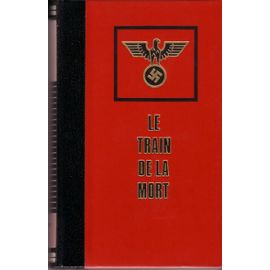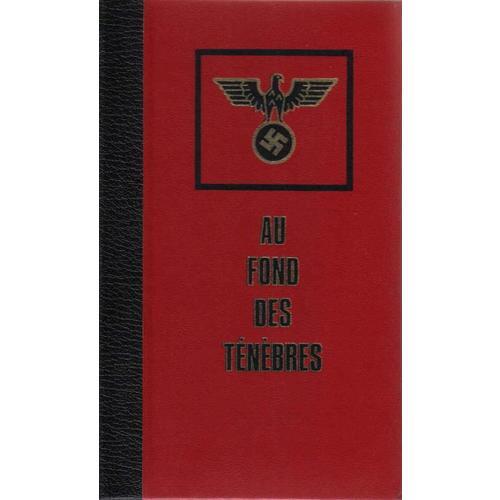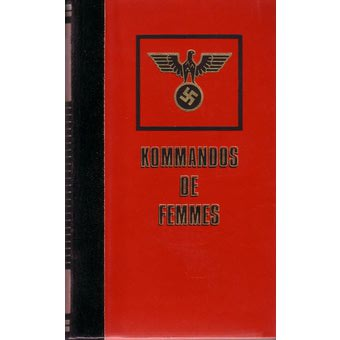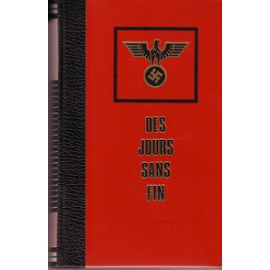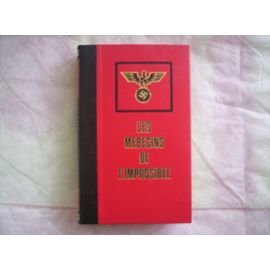Liste de livres pour la collection : Seconde guerre mondiale
Recherche : Cat?gorie DESC
Les 7 de Spandau (2008)
Histoire
De 1947 à 1987, sept ex-dignitaires nazis condamnés par le tribunal de Nuremberg purgent leur peine dans la prison de Spandau, à Berlin. Parmi eux, Rudolf Hess, le troisième homme du régime nazi, et Albert Speer, l'architecte d'Hitler et ministre de l'Armement du IIIe Reich. A Spandau, le règlement est drastique. Les seuls qui sont autorisés à échanger avec les détenus, une fois par semaine, sont les pasteurs nommés aumôniers de la prison. Pendant quarante ans, douze hommes de foi se succèdent auprès d'eux, leur parlent et écoutent leurs obsessions. Des questions inévitables se posent devant ces criminels parmi les pires de l'Histoire : prennent-ils conscience, au fil des années, des horreurs du régime nazi ? Que ressentent-ils face à leur châtiment ? Mais aussi, du point de vue de l'homme de foi, comment aborde-t-on quelqu'un qui a participé à de telles atrocités ? Les pasteurs de Spandau sont français, trois sont encore en vie. Ces grands témoins de l'Histoire ont accepté, pour la première fois, de raconter leur expérience. Un témoignage passionnant, une véritable incursion dans les méandres de la nature humaine.
La liste de Schindler (1994)
Histoire
Seconde guerre mondiale. L'histoire vraie de Oskar Schindler qui démarra son usine en Pologne avec des juifs déportés. Découvrant peu à peu l'horreur que son propre peuple fait subir aux juifs, il décident de sauver tous ceux qu'il pourra...
La grande raffle du Vel d'Hiv (2010)
Histoire
Le 16 juillet 1942, à l'aube, débute à Paris une vaste opération policière, baptisée Vent printanier . Voulue par les autorités allemandes, elle mobilise près de 9 000 hommes des forces du gouvernement de Vichy. Ce jour-là et le lendemain, 12 884 juifs sont arrêtés, dont 4 051 enfants. Tandis que les célibataires et les couples sans enfants sont directement conduits au camp d'internement de Drancy, les familles, soit plus de 7 000 personnes, sont détenues au Vélo-drome d'Hiver. Elles y demeurent plusieurs jours, jusqu'à leur internement à Pithiviers et à Beaune la Rolande (avant d'être déportées vers les camps de concentration d'Allemagne et de Pologne), dans des conditions épouvantables : entassées dans les gradins, dans une chaleur épouvantable, presque sans eau, ni vivres. Fruit d'une longue enquête, La Grande Rafle du Vel d'Hiv met en évidence de façon saisissante la responsabilité du gouvernement de Vichy dans la déportation des Juifs de France. Il demeure encore aujourd'hui le document de référence sur le crime du Jeudi noir de juillet 1942.
Une femme à Berlin (2008)
Histoire
La jeune Berlinoise qui a rédigé ce journal, du 20 avril 1945 - les Soviétiques sont aux portes - jusqu'au 22 juin, a voulu rester anonyme, lors de la première publication du livre en 1951, et après. A la lecture de son témoignage, on comprend pourquoi. Sur un ton d'objectivité presque froide, ou alors sarcastique, toujours précis, parfois poignant, parfois comique, c'est la vie quotidienne dans un immeuble quasi en ruine, habité par des femmes de tout âge, des hommes qui se cachent : vie misérable, dans la peur, le froid, la saleté et la faim, scandée par les bombardements d'abord, sous une occupation brutale ensuite. S'ajoutent alors les viols, la honte, la banalisation de l'effroi. C'est la véracité sans fard et sans phases qui fait la valeur de ce récit terrible, c'est aussi la lucidité du regard porté sur un Berlin tétanisé par la défaite. Et la plume de l'auteur anonyme rend admirablement ce mélange de dignité, de cynisme et d'humour qui lui a permis, sans doute, de survivre.
6 juin 1944 : Le débarquement en Normandie (2004)
Histoire
A l'aube du mardi 6 juin 1944, plus de 200000 hommes, Britanniques, Américains, Canadiens et Français, débarquent sur les plages normandes, baptisées Omaha, Utah, Gold, Juno et Sword. Depuis 1942, Churchill, le Premier ministre anglais, et Roosevelt, le président des Etats-Unis préparaient l'opération Overlord, la plus grande opération amphibie de tous les temps. Elle s'engage ce matin-là sous les ordres d'Eisenhower, général américain, commandant suprême des forces alliées, et du général britannique Montgomery. En nous faisant revivre les deux mois de la bataille de Normandie, Anthony Kemp retrace la phase ultime de la libération de l'Europe.
Dans le bunker de Hitler (2004)
Histoire
Ce militaire de carrière a vu Hitler tous les jours pendant les derniers mois du Reich. Bien qu'il ne fût pas nazi, il a vécu la dernière semaine du régime à demeure, avant de s'échapper quand le bunker fut définitivement coupé du monde, le 29 avril 1945. Capturé par les Anglo-Saxons, il a noirci quatre carnets de notes, puis il s'est tu pendant soixante ans. François d'Alançon l'a convaincu de raconter son expérience : les neuf derniers mois du Troisième Reich. Bernd Freytag von Loringhoven est un second rôle clef : aide de camp des généraux Guderian et Krebs, il assiste chaque jour aux réunions de situation militaire dirigées par Hitler et il est en liaison avec tous les fronts. Son récit, d'autant plus impressionnant qu'il est dépourvu de toute dramatisation superflue, décrit une paralysie entrecoupée d'espoirs - les armes secrètes, l'offensive des Ardennes, l'armée de Wenck dans Berlin déjà occupé - jusqu'à la prise de conscience, fin avril 1945, de la mise échec et mat. Il saisit sur le vif les acteurs - de Göring à Keitel, de Himmler à Bormann, de Goebbels à Ribbentrop ; tout en restituant une ambiance, il chronique de l'intérieur les étapes de la défaite et les stratégies personnelles de ce premier cercle. Il brosse surtout une fresque saisissante du dernier Hitler, le survivant de l'attentat obnubilé par sa vengeance, le chef de guerre dos au mur à la recherche d'une victoire théâtrale, le Führer en quête d'un empire en ruine. Ainsi ce témoignage unique échappe-t-il au constat pour atteindre à la leçon : l'histoire au plus près est le meilleur antidote contre la complaisance.
La destruction des Juifs d'Europe - tome 1 (2006)
Histoire
L'ouvrage au titre terrible de Raul Hilberg est l'oeuvre de toute une vie. Pendant trente-six ans, l'auteur a sondé les centres d'archives de l'Europe entière afin de répondre à une question : comment cet événement sans précédent qui eut pour résultat le meurtre de plus de cinq millions de personnes a-t-il pu avoir lieu ? Refusant de s'en tenir au seul constat d'une catastrophe morale, Hilberg analyse minutieusement les étapes qui, de la définition des Juifs par l'administration allemande des années trente à la Solution finale, ont jalonné le processus de destruction.
Par un traitement exhaustif des sources disponibles, l'auteur apporte patiemment la preuve que rien n'a été laissé au hasard dans l'organisation du système criminel des nazis. À l'appui de cette thèse, les décrets et notes de service du IIIe Reich prouvent le caractère méthodique de l'opération. La conclusion est implacable.
La destruction des Juifs d'Europe - tome 2 (2006)
Histoire
L'ouvrage au titre terrible de Raul Hilberg est l'oeuvre de toute une vie. Pendant trente-six ans, l'auteur a sondé les centres d'archives de l'Europe entière afin de répondre à une question : comment cet événement sans précédent qui eut pour résultat le meurtre de plus de cinq millions de personnes a-t-il pu avoir lieu ? Refusant de s'en tenir au seul constat d'une catastrophe morale, Hilberg analyse minutieusement les étapes qui, de la définition des Juifs par l'administration allemande des années trente à la Solution finale, ont jalonné le processus de destruction.
Par un traitement exhaustif des sources disponibles, l'auteur apporte patiemment la preuve que rien n'a été laissé au hasard dans l'organisation du système criminel des nazis. À l'appui de cette thèse, les décrets et notes de service du IIIe Reich prouvent le caractère méthodique de l'opération. La conclusion est implacable.
Le commandant d'Auschwitz parle (2004)
Histoire
Dans sa première édition, en 1959, le Comité international d'Auschwitz présentait ainsi ce livre : Rudolf Hoess a été pendu à Auschwitz en exécution du jugement du 4 avril 1947. C'est au cours de sa détention à la prison de Cracovie, et dans l'attente du procès, que l'ancien commandant du camp d'Auschwitz a rédigé cette autobiographie sur le conseil de ses avocats et des personnalités polonaises chargées de l'enquête sur les crimes de guerre nazis en Pologne. [...] Conçu dans un but de justification personnelle, mais avec le souci d'atténuer la responsabilité de son auteur en colorant le mieux possible son comportement, celui de ses égaux et des grands chefs SS, ce document projette une lumière accablante sur la genèse et l'évolution de la Solution finale et du système concentrationnaire. Ce compte rendu sincère représente l'un des actes d'accusation les plus écrasants qu'il nous ait été donné de connaître contre le régime dont se réclame l'accusé, et au nom duquel il a sacrifié, comme ses pairs et supérieurs, des millions d'êtres humains en abdiquant sa propre humanité. La préface de Geneviève Decrop (auteur de l'ouvrage Des camps au génocide : la politique de l'impensable, PUG, 1995) replace en perspective ce texte fondamental. Et dans la post-face inédite à cette édition de poche, elle montre en quoi les avancées récentes de l'historiographie de la Shoah renouvellent la portée de sa lecture.
Paroles du jour J (2004)
Histoire
C'est une histoire à mille voix, écrite dans l'émotion du moment : elle nous raconte, vus de chaque camp, le débarquement, ses préparatifs, et la bataille de Normandie. Découvrez les lettres et les journaux intimes que les soldats alliés, les civils et leurs ennemis ont écrit au milieu des combats, sur les bateaux, sur les plages ou dans les haies du bocage. Confidences, dernières volontés, déclarations d'amour ou d'effroi? Chacun de ces textes reflète le besoin vital de laisser une trace en cas de disparition. Au fil des pages, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'adversaires, de civils ou de militaires, mais seulement des hommes, des femmes et des enfants jetés dans la tourmente. Ils écrivent dans la fièvre de l'action, de la peur, de l'attente ou de la joie, pour nous faire vivre de l'intérieur l'un des plus grands séismes de l'histoire.
Politique Nazie, travailleurs juifs ... (2002)
Histoire
A travers ces questions, Christopher R.Browning apporte de nouveaux éléments sur la compréhension du génocide juif. Grâce à de nombreux documents d'époque (lettres, témoignages des victimes et bourreaux), l'auteur accorde un soin minutieux à analyser l'action personnelle des individus chargés d'exécuter cette politique de destruction totale. Il révèle les comportements, les motivations ou réactions d'hommes face à leurs actes mais surtout leurs aptitudes à une totale inhumanité.
Auschwitz, les nazis et la solution finale (2005)
Histoire
Le 27 janvier 1945, l'armée Rouge pénètre dans le camp de concentration d'Auschwitz et libère les derniers survivants. Le monde découvre un système d'une barbarie inouïe et jamais vue dans l'histoire de l'humanité : la Solution finale, les chambres à gaz et les fours crématoires. S'appuyant sur les meilleures sources historiques et sur une centaine d'entretiens inédits avec d'anciens bourreaux et des rescapés, Laurence Rees nous permet de comprendre de l'intérieur le fonctionnement de cette machine à tuer. La force et l'originalité de cette enquête unique sont de montrer comment les décisions qui ont abouti à la construction des camps ont mûri des années durant. Et l'on découvre, incrédules, qu'aujourd'hui encore nombre d'anciens nazis justifient leurs crimes par un simple et atroce : Je pensais que c'était une bonne chose.
La traque d'Eichmann (2011)
Histoire
Comment une équipe de chasseurs de nazis, composée de survivants et de jeunes agents israéliens, traqua le plus recherché des criminels de guerre. Printemps 1945. Alors que les Alliés libèrent l'Allemagne et arrêtent les hauts dignitaires nazis, le maître d'oeuvre de l'extermination des Juifs, abandonnant son uniforme de colonel SS, disparaît soudain dans la nature. Ce colonel, Adolf Eichmann, aura passé quinze années de sa vie à fuir, d'un camp de prisonniers à une cabane de bûcherons, avant d'être arrêté dans un faubourg misérable de Buenos Aires. Au fil de cette chasse à l'homme menée sur trois continents, apparaissent des personnages éminemment romanesques, parmi lesquels un juge allemand obstiné et un vieil homme aveugle secondé par sa fille, ainsi qu'un service secret israélien qui commence à faire parler de lui : le Mossad. Tous ont raconté à l'auteur leur version de l'histoire - qui aboutit en 1962 à Jérusalem au procès retentissant et à l'exécution du criminel nazi, incarnation de la banalité du mal selon Hannah Arendt. Haletant comme un roman d'espionnage, La Traque d'Eichmann est nourri d'entretiens et d'archives accessibles pour la première fois.
Prisonniers de guerres ... dans le sud du Qc (2010)
Histoire
Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement canadien mit sur pied cinq camps d internement pour prisonnier et internés allemands dans le sud du Québec (Farnham, Grande-Ligne, île-aux-Noix, Sherbrooke et Sorel). Cet ouvrage analyse le fonctionnement de ces camps. Il évoque aussi la vie derrière les barbelés et les tensions physiques et psychologiques auxquelles furent soumis ces hommes. Il porte également un regard sur les programmes d éducation conçus à leur intention
Les mensonges du III Reich (2007)
Histoire
Que ce soit pour préparer l'ascension du régime nazi, le maintenir au pouvoir, perpétuer sa gloire ou cacher ses crimes atroces, les architectes du IIIe Reich ont eu recours à une multitude de mensonges dont certains perdurent encore aujourd'hui. Des raisons de la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale aux prétendus bienfaits du régime hitlérien (les autoroutes, la baisse de la criminalité), des moeurs de ses dirigeants (morphinomanes, occultistes) jusqu'à la solution finale qui cachait l'extermination...
Ne tirez pas ! (2008)
Histoire
Le 27 décembre 1944, la corvette canadienne St Thomas effectue un grenadage contre le sous-marin allemand U-877 et le contraint à faire surface. Passant outre aux lois de la guerre suggérant aux attaquants d'abandonner les marins ennemis en perdition dans les flots, le commandant en second Stanislas Déry décide de les recueillir à son bord. Une scène inouïe de fraternité se joue alors dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. En quelques minutes, le destin de ces soldats va changer de cours... Stanislas Déry et son homologue allemand, l'Oberleutnant zur See Peter Heisig, noueront un lien exceptionnel durant plus d'un demi-siècle. Nourri par le témoignage des survivants et la correspondance des officiers, Ne tirez pas ! est le récit d'une amitié improbable, mais aussi celui de l'incroyable bataille qui opposa les Loups gris de la Kriegsmarine aux navires alliés dans l'ultime phase du second conflit mondial. Alain Stanké, auteur et réalisateur, a tiré de cette aventure un documentaire diffusé sur les grands réseaux de télévision.
Les Einsatzgruppen (2007)
Histoire
Constitués à l'origine de volontaires issus de la S5, les Einsatzgruppen (groupes d'intervention), sont actifs dès 1939. Réorganisés au printemps 1941, ils opèrent à partir du 22 juin 1941 sur le front de l'Est, derrière la Wehrmacht, et étoffent massivement leurs effectifs au cours des dix-huit mois suivants. Donné avant l'offensive, l'ordre de tuer les cadres du régime soviétique et les hommes juifs adultes bascule en décision génocidaire dans la première semaine du mois d'août 1941. Loin d'être éloignée du massacre, la Wehrmacht en est le premier témoin oculaire tout en prêtant souvent main-forte aux tueurs. En moins de cinq mois, le massacre devient un génocide à l'échelle de l'URSS d'abord (août 1941), puis à celle du continent européen tout entier (novembre 1941). Les tueries par fusillades opérées par les Einsatzgruppen constituent le laboratoire de la solution finale. La machine génocidaire connaît toutefois des ratés. À partir de la tuerie de Minsk à laquelle il assiste le 15 août 1941, Himmler se déclare convaincu qu'il faut mettre au point un autre moyen de mise à mort, plus rapide et discret, moins éprouvant surtout pour les tueurs. Ce sera le camion à gaz (Chelmno, décembre 1941), puis la chambre à gaz. Les volontaires du meurtre de masse n'étaient pas des hommes ordinaires, mais les héritiers d'un endoctrinement pour lequel tout Juif constituait une nuisance à éradiquer. La force des Einsatzgruppen tient à la convergence de l'endoctrinement, de l'esprit de corps qui ouvre le chemin aux exactions de groupe, et d'une coupure d'avec le monde traditionnel qui permet de lever les inhibitions. Ralf Ogorreck analyse le recrutement, la formation et le modus operandi de ceux qui mirent en oeuvre cette Shoah par balles dont on commence à peine à mesurer l'ampleur.
Des voix sous les cendres (2005)
Histoire
Entre 1942 et novembre 1944, l'Allemagne nazie assassine dans les chambres à gaz d'Auschwitz -Birkenau plus d'un million de personnes, des Juifs européens dans leur immense majorité. Un Sonderkommando (unité spéciale), constitué de détenus juifs qui se relaient jour et nuit, est contraint d'extraire les cadavres des chambres à gaz, de les brûler dans les crématoires et de disperser les cendres. Quelques hommes ont transcrit ces ténèbres et ont enfoui leurs manuscrits dans le sol de Birkenau. Cinq de ces textes ont été retrouvés après la guerre. Aucun de leurs auteurs n'a survécu, les équipes étant liquidées et remplacées à intervalles réguliers. Ce sont trois de ces manuscrits, dans une nouvelle traduction du yiddish pour partie inédite en français, qui sont présentés ici. La terreur, qui est la règle à Birkenau, est la toile de fond de cette histoire. C'est d'elle dont parlent tous les manuscrits retrouvés. Du silence, de l'absence d'évasion, de ce monde à l'envers où le meurtre est devenu la norme et l'impératif moral d'un peuple saisi d'une angoisse obsidionale. S'y ajoutent les dépositions lors du procès de Cracovie en 1946, de trois rescapés des Sonderkommandos, témoignages qui confirment, entre autres, l'intensité du massacre des Juifs de Hongrie au printemps 1944, les documents d'histoire, les photos de déportations, les archives allemandes. Témoignages qui racontent la panique de la chambre à gaz, des victimes mortes asphyxiées, piétinées avant même que n'opère le gaz, dans des scènes à proprement parler inimaginables. Mais qui évoquent aussi la jouissance prise à humilier et à martyriser autrui, le sadisme sans limites, puisque tout était permis contre un peuple placé hors humanité.
Stalingrad (1999)
Histoire
La bataille de Stalingrad représente sans doute le tournant principal de la Deuxième Guerre mondiale, en même temps que l'un des plus grands drames humains qu'ait jamais engendrés un conflit.
C'est à Stalingrad, en effet, sur les bords de la Volga, que se brisa à jamais, au coeur du terrible hiver 1942-1943, le rêve hitlérien de soumission de la Russie et de conquête d'un Empire oriental sans précédent pour le « Reich millénaire ». C'est là aussi et surtout que se brisa l'Armée allemande. La Wehrmacht, naguère triomphante, perdit à Stalingrad beaucoup plus que les 275 000 hommes pris au piège dans les ruines d'une cité devenue symbole. Elle y perdit son âme et la conviction de son invincibilité. Après Stalingrad, elle ne sera plus jamais la même.
La chute de Berlin (2002)
Histoire
Avec son magistral Stalingrad, rapidement devenu un best-seller mondial, Antony Beevor avait réussi à donner toute son ampleur tragique à l'une des plus terribles batailles de l'histoire de l'humanité. Le récit de la chute de Berlin, qui consacre, en 1945, l'effondrement du Troisième Reich et du rêve hitlérien de domination mondiale, était, comme il le souligne dans sa préface, la suite logique de cet ouvrage, en même temps que l'évocation d'un drame humain à peu près sans précédent. C'est, en effet, avec une terrible soif de vengeance, après les exactions commises par les Allemands en Russie, que l'Armée rouge atteint les frontières du Reich puis s'approche inexorablement de Berlin, devenu pour elle l'antre de la bête fasciste. Et cette vengeance sera effroyable : villes et villages anéantis, civils écrasés par les chenilles des chars, viols et meurtres en série, pillage systématique. Des centaines de milliers de femmes et d'enfants vont périr, souvent de faim ou de froid, et plus de sept millions de personnes s'enfuiront vers l'ouest pour tenter d'échapper à la mort et à la terreur. Mais, en même temps qu'il est assailli par un ennemi à l'incroyable férocité - encore que quelques traits d'humanité viennent parfois éclairer une fresque digne de Goya -, le peuple allemand est souvent sacrifié par des gouvernants que l'orgueil et le fanatisme conduisent à l'aberration la plus meurtrière. S'appuyant sur des archives souvent inédites, Antony Beevor nous livre non seulement un document historique capital, mais aussi un grand récit tragique et poignant, où l'on voit se déchaîner, portées à leur paroxysme, toutes les passions humaines, où l'orgueil rejoint la folie, la ruse côtoie la bêtise, l'héroïsme cohabite avec la peur, l'abnégation avec la cruauté.
Les hommes du bunker (1976)
Histoire
Les SS, un avertissement de l'histoire (2006)
Histoire
Incarnation de la terreur, exécuteurs du génocide, les SS représentent comme nulle autre organisation toute la folie du IIIe Reich. Comment la petite garde rapprochée de Hitler s'est-elle muée en quelques années en Etat dans l'Etat totalitaire du Führer ? Qui étaient ses têtes pensantes ? Que sont devenus ses membres survivants après la guerre ? Guido Knopp se livre ici à un bilan sur l'histoire de la SS, du vivant des dernières victimes et des derniers bourreaux. Il s'appuie sur de nombreuses sources inédites et fait parler des témoins qui ne s'étaient jamais exprimés. Un outil indispensable pour une meilleure compréhension de la période la plus sombre du XXe siècle.
La face cachée d'Adolf Hitler (2002)
Histoire
Le plus grand dictateur du XX° siècle aurait eu une jeunesse invertie. Pour explorer cette hypothèse, Lothar Machtan reprend pas à pas la biographie d'Hitler à partir de 1908, témoignage et documents à l'appui. Un quart de siècle plus tard, parvenant au pouvoir, Hitler doit tenir compte de l'opinion publique et de celle du maréchal von Hindenburg, homophobe endurci. Il fait éliminer au cours de la Nuit des longs couteaux, en 1934, plusieurs témoins gênants de ses frasques de jeunesse, dont Gregor Strasser, Ernst Röhm, le chef des sections d'assaut et homosexuel notoire, ainsi que tous ceux qui tentèrent de le faire chanter ou de révéler la vérité... Quant aux rapports qu'entretenait le Führer avec les femmes, notamment sa nièce, Geli Raubal, qui se suicida, et Eva Braun, il semblerait qu'ils aient juste servi de façade.
La conspiration oubliée (2004)
Histoire
Septembre 1938. Après avoir bafoué le traité de Versailles et envahi l'Autriche, Hitler a les yeux rivés sur les Sudètes. Le lieutenant-colonel Oster, membre des renseignements militaires allemands, qui a vu le dictateur à l'?uvre depuis 1933, est convaincu qu'il faut agir au plus vite afin d'éviter l'annexion des Sudètes et sa conséquence directe la guerre mondiale. Pour mener à bien son entreprise, Hans Oster parvient à réunir un réseau de choc : généraux de la Wehrmacht, membres de la police berlinoise, autorités civiles et religieuses ainsi qu'un groupe de patriotes prêts à tout. Tout est en place. Le coup d'Etat aura lieu dès que Hitler donnera l'ordre d'envahir la Tchécoslovaquie.
Violences et crimes du japon en guerre 1937-1945 (2009)
Histoire
Massacres en masse de prisonniers de guerre, notamment à Nankin ; asservissement de millions d'Asiatiques et d'Occidentaux, entre camps de la faim et chantiers de la mort ; atmosphère de terreur à l'échelle d'un quasi-continent ; débauche de crimes sexuels et prostitution forcée ; utilisation de cobayes humains ; pillage généralisé ; intoxication par la drogue de populations entières. Cela dura huit ans et toucha 400 millions d'êtres humains. Ce terrifiant volet de la Seconde Guerre mondiale n'avait jamais fait l'objet jusqu'à présent d'une étude approfondie et globale. Les pratiques meurtrières de l'armée de l'Empereur du Japon sont minutieusement décrites, afin d'en comprendre les mécanismes. Comment en arriva-t-on là, dans un pays qui était apparu comme un modèle de modernité ? Les explications, trop simples, par la culture ou le contexte ne tiennent pas. C'est la conquête d'une armée par l'ultranationalisme, puis la conquête d'un pays par le militarisme qui sont en cause. Au-delà, c'est l'ère du fascisme, des totalitarismes, du triomphe de la brutalité qui trouva au Japon un formidable point d'appui. Ces horreurs des années 1937-1945 restent aujourd'hui au c?ur des mémoires et des controverses historiques au Japon, en Chine, ainsi que dans les autres pays asiatiques. Pour comprendre à la fois les totalitarismes d'hier et l'Asie d'aujourd'hui, il était indispensable de mettre en lumière ces violences massives et méconnues.
Petit-Saguenay, Une tradition du patrimoine humain (2006)
Histoire
Petit-Saguenay doit être avant tout considérée comme la pionnière du développement industriel de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le village de l'Anse-Saint-Étienne, érigé par la Compagnie Price témoigne d'une activité économique significative qui employa jusqu'à près de 500 personnes à sa scierie et à ses chantiers pendant 17 ans (1883-1900).
La première moitié du XXe siècle marque un troisième développement. Celui-là est axé le long de la rivière Petit-Saguenay. La formation de l'administration municipale, scolaire et religieuse sont les bases d'un village permanent dont le peuplement est favorisé suite à l'érection de moulins à scie et à l'établissement de réseaux de communications en ce lieu. Le commerce et l'agriculture naissent et se développent pendant cette période.
La décennie 1940 annonce le début de l'ère de la modernisation du village : électrification, construction de routes, d'un réseau d'acqueduc et d'égoût, d'institutions d'enseignement et financière ainsi que d'un quai sont des atouts qui favorisent le développement du village.
Aujourd'hui, Petit-Saguenay est une municipalité centrée sur les industries de la forêt (omniprésentes depuis sa fondation, il y a plus d'un siècle et demi) et du tourisme. Cette dernière est en émergence depuis la décennie 1980. Le Village-vacances, le Club des Messieurs (site récréopatrimonial de la rivière Petit-Saguenay) et le symposium provincial des villages en couleurs L'Anse-Saint-Jean-Petit-Saguenay représentent des apports significatifs qui assurent le développement de l'économie touristique saguenoise.
Le dernier train d'Hiroshima (2011)
Histoire
En s appuyant sur le témoignage des survivants des bombes d'Hiroshima et de
Nagasaki, Charles Pellegrino retrace les événements des deux jours d'août 1945 durant lesquels des engins atomiques ont explosé sur le Japon, changeant à jamais la vie sur Terre. Au c ur de ce récit, la voix de ceux qui ont vécu les premiers les explosions atomiques: les civils japonais et les aviateurs américains.
Trente personnes sont connues pour avoir fui Hiroshima par le train pour Nagasaki, où ils sont arrivés juste à temps pour assister à la seconde bombe. Charles Pellegrino raconte leur histoire et laisse entre autres la parole à Tsutomu Yamaguchi, une des rares personnes à avoir survécu deux fois aux effets du cataclysme depuis Ground Zero.
La seconde fois, une cage d'escalier lui servit de cocon, tandis que l'ensemble du bâtiment disparut tout autour de lui.
Le Bienveillantes (2006)
Histoire
Avec cette somme qui s'inscrit aussi bien sous l'égide d'Eschyle que dans la lignée de Vie et destin de Vassili Grossman ou des Damnés de Visconti, Jonathan Littell nous fait revivre les horreurs de la Seconde Guerre mondiale du côté des bourreaux, tout en nous montrant un homme comme rarement on l'avait fait : l'épopée d'un être emporté dans la traversée de lui-même et de l'Histoire.
Les disparus (2007)
Histoire
Dans la famille de Daniel Mendelsohn, il y a un trou : en 1941, son grand-oncle, sa femme et leurs quatre filles ont disparu dans l?est de la Pologne. Comment sont-ils morts ? Nul ne le sait. Pour résoudre cette énigme, l?auteur part sur leurs traces. Le résultat ? Non un énième récit sur la Shoah, mais un formidable document littéraire, à la fois enquête dans l?Histoire et roman policier. Écoutons ceux qui l?ont lu : Joyce Carol Oates : « Daniel Mendelsohn a écrit une oeuvre puissamment émouvante sur le passé ?perdu? d?une famille, qui rappelle à la fois l?opulence des oeuvres en prose de Proust et les textes elliptiques de W.G. Sebald.» Jonathan Safran Foer : « Entre épopée et intimité, méditation et suspense, tragédie et hilarité, Les Disparus est un livre merveilleux. »
La seconde guerre mondiale - témoins de l'histoire (2004)
Histoire
Compilation des 5 tomes parus en 2002 chez Acropole, cette somme réunit en un seul volume la première série de « Témoins de l?Histoire », qui, n?omettant aucun des acteurs et des lieux qui ont fait la seconde guerre mondiale, mobilise l?ensemble des connaissances actuelles sur le sujet, grâce notamment à l?ouverture des archives soviétiques et des anciennes démocraties populaires. Richement illustré de documents dont la plupart sont rarissimes et inédits, ce livre est une aide inestimable pour comprendre ces années durant lesquelles le monde s?est embrasé.
Afficher plus
Réduire
Conçu et réalisé par Serge Paradis @ ma-collection.com, 2000-2023. Tous droits réservés.